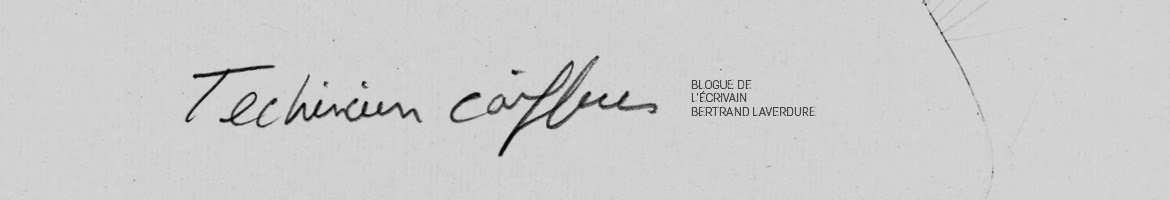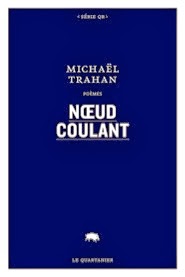Je me souviens qu’à une certaine époque, Voir présentait un
Top 5 en poésie québécoise, à la
fin de l’année. Peut-être ai-je rêvé, peut-être suis-je en train de délirer,
chose certaine on parle peu de poésie d’ici dans les bilans annuels
palmarèsistiques. Je ne suis pas le seul à le penser, car mon amie et poète,
Véronique Cyr, s’insurgeait récemment de cet état de fait sur sa page Facebook.
Quelques commentaires plus tard, nous en sommes arrivés à la
conclusion qu’il fallait rédiger nous-mêmes ces notices. Première constatation,
nous ne voulions pas d’un palmarès ni d’un «top (ajoutez le chiffre que vous
voulez)». Véronique et moi souhaitions seulement témoigner de nos lectures appréciées
de cette année, surtout celles qui n’ont pas reçu une attention médiatique (de
très gros mots inappropriés pour la poésie) convenable selon nous.
Peut-être que Le Devoir, La Presse ou Voir seront inspirés
par notre mouvement d’amour pour la poésie d’ici ? Nous sommes persuadés
toutefois que nos choix sauront souligner le merveilleux travail des éditeurs
de poésie québécoise autant que le talent de ceux qui l’écrivent.
Pourquoi ne pas offrir de la poésie aux gens que vous aimez
à Noël ? C’est beaucoup mieux qu’une carte Hallmark, c’est singulier et en plus
ça peut même se glisser dans un bas traditionnel blanc et rouge cloué sur le manteau de
votre cheminé ou sur votre mur en gyproc !
Mais au-delà des arguments de vente nous voulions souligner
à quel point la poésie d’ici se porte bien et comment il nous fait plaisir de
la faire connaître.
Chaque livre est associé à un lien qui vous enverra sur la page du site d'achat en lignes des LIBRAIRES, (Le portail des librairies indépendantes du Québec) qui vous donnera la possibilité de le commander directement et d'en faire profiter un libraire indépendant près de chez vous.
Chaque livre est associé à un lien qui vous enverra sur la page du site d'achat en lignes des LIBRAIRES, (Le portail des librairies indépendantes du Québec) qui vous donnera la possibilité de le commander directement et d'en faire profiter un libraire indépendant près de chez vous.
Voilà le résultat.
Après les puissants dixhuitjuilletdeuxmillequatre
et Le nouveau temps du verbe être,
Roger des Roches, lauréat 2013 du prix Athanase-David, nous revient avec La cathédrale de tout, là où :
« La langue qui danse avec la langue.
Danse et fait le blanc et blanc du pas à pas.
Il faut dévorer les émeutes, et j’imprime des chefs.(…) Le
bon abîme, le bloc de brûle. » Chez Des Roches, la poésie renoue avec la
voyance telle que l’entendait Rimbaud et sa violence est un feu qui éclaire
dans le noir.
|
|
|
Dix ans
après la parution de Le siège propre chez
Triptyque, Caroline Louisseize
effectue un retour en poésie chez
Poètes de brousse avec un très beau
recueil qui joue sur les registres du souffle et de l’attente du pire; le
terme Aura renvoyant à un phénomène neurologique précédant la crise
épileptique. Tout en dépouillement et en métaphores inquiétantes.
« Clefs
du vertige
les rideaux
coulent
dans la
rivière des petits feux
un jour à
la fois
une
chandelle pour chaque soupir. »
|
Après avoir convoqué Hölderlin, Rimbaud et Supervielle
dans Les Bras de Bernstein (Les herbes rouges, 2011), Philippe Drouin nous
fait plonger, cette fois, dans un univers éclaté où la Nuit de cristal,
pogrom antijuif de 1938, tient lieu de fil d’Ariane entre les blocs de poèmes
en prose habilement construits dans une ambiance traversée par la grâce et
l’effroi :
|
|
Premier recueil de ce jeune auteur né à Acton Vale, Nœud
coulant est un des livres de poésie les plus percutants et prometteurs parus
en 2013. La langue est fluide, forte, les poèmes sont portés par une voix qui
cherche et trouve toujours son équilibre malgré le nœud coulant d’une perte
de contrôle annoncée. On pense à Saint-Denys-Garneau, on entend le souffle de
Tristan Corbières, la parole qui s’y déploie est essentielle. Un grand auteur
à voir évoluer.
« Une poignée de braise
quelques cailloux rouges
autour de quoi s’affoler :
même le pire des enfers
est habitable. »
|
|
|
Huitième livre de poésie de Thierry Dimanche, Théologie
hebdo fait le lien entre ses Encycliques désaxées et ses
Autoportraits-robots. Poète baroque à la langue foisonnante multipliant les paradoxes
et les alogismes, qui décortique les diverses figures du père, ici même de
Djeu, un «Dieu jeu», un «Dieu je», d’où l’idée de la «théologie», Dimanche
nous offre ici une de ses œuvres les plus marquantes. Les poèmes du livre
sont distribués suivant la structure éditoriale d’un hebdo, d’un journal,
soit dans des rubriques de sports, des éditoriaux, des sections voyage,
courrier du cœur ou art. Œuvre totale, tous les sujets y sont abordés. Excroissance théologique du «je»,
explorations des états d’âmes amoureux, expositions de toutes les fictions du
sujet, des avatars de nos moi redondants, Théologie hebdo est une espèce de
traité ludique et brillant sur tout ce qui contribue à solidifier la fiction
de notre moi.
« Maître de rien, libre avec tout, quand le
revirement tendu fait loi de l’échouage retenti dans son contraire et que le
vœu ranime sans le vouloir ses fléchissements ancestraux, à rebours d’une
descente nous détruisant de l’avant. »
|
|
|
Maude Veilleux a publié plusieurs fanzines et a participé
à plusieurs lectures publiques mais nous offre ici son premier recueil
officiel. Le titre de son livre, qui rappelle une chanson de Lisa Leblanc, a
le mérite de sa franchise vulgaire. Dans les poèmes d’amour déçu, de
dépendance amoureuse désolante de Veilleux, rien de trop, une ligne parfois,
une seule, et l’émotion naît, nous percute. Entre le minimalisme de Patrice
Desbiens et le joual sauvage de Mononc’ Serge, cette poésie réussit à fixer
des instants de dépits amoureux avec un maximum d’efficacité littéraire.
Excellent premier livre.
« J’ai envie de te toucher
Plus longtemps
Que le temps que
Tu viennes »
|
|
|
Poète québécois majeur, au style singulier, Desgent a
publié de nombreux livres mais c’est avec la sortie de Vingtièmes siècles,
fresque historique démesurée, chant apocalyptique grandiose à la langue
rythmée et graveleuse, qu’il acquiert sa renommée. Depuis Portraits de
famille, le poète s’intéresse à ses morts. Dans Ne calme pas les dragons, il
nous offre d’autres superbes poèmes qui atteignent le «mal-dit», et traitent
tout aussi bien de ses morts que de ses amours mortes. Poète à entendre en
lecture publique. Grand performeur.
«Toi moi un corps non :
je dis un mystère est-ce que la langue est au début/
le cœur s’inverse ça saute ça manque
ça fait de la poitrine maigre»
|
|
|
Martine Audet, un peu à la manière de Sarraute,
s’intéresse aux tropismes, à l’infra-ordinaire, au quotidien minuscule de
l’amour et des émotions. Sa parole distincte, reconnaissable entre toutes,
son unité de ton, cette patience esthétique qu’elle déploie en faisant mûrir
«les nerfs d’une phrase» en font une voix incontournable de nos lettres
contemporaines. Dans son dernier recueil, on retrouve l’Audet de ses grands
livres comme Les tables et Les manivelles. Excellente porte d’entrée pour
ceux qui ne la connaissent pas encore. En prime, une belle œuvre
photographique de la poète en couverture.
« J’enveloppe les jours
Que je ne comprends pas
Dans du papier journal»
|
|
|
Annie Lafleur poursuit une œuvre exigeante. Ses poèmes
sont des concrétions cristallisées d’allusions à des expériences corporelles,
physiques, des références cryptées, des précipités d’émotions réduits dans la
cornue de son imaginaire. Son recueil que je préfère : Handkerchief.
Dans son dernier opus, elle nous propose des poèmes minimalistes, à la limite
sériels. Peu de mots, des bouts de fils sur la page, mais sculptés. Le titre,
Rosebud, évoque le secret du film d’Orson Wells (Citizen Kane), mais c’est
aussi une façon de dire que si l’on fait bouillir la beauté, il en reste
toujours des matières coupantes, des éclats de verre, des tortures d’allégresse.
Lafleur connaît mieux que quiconque les insatiables douleurs de l’extase
artistique ou amoureuse.
«doberman pitbull
rottweiler/ assener la beauté »
|